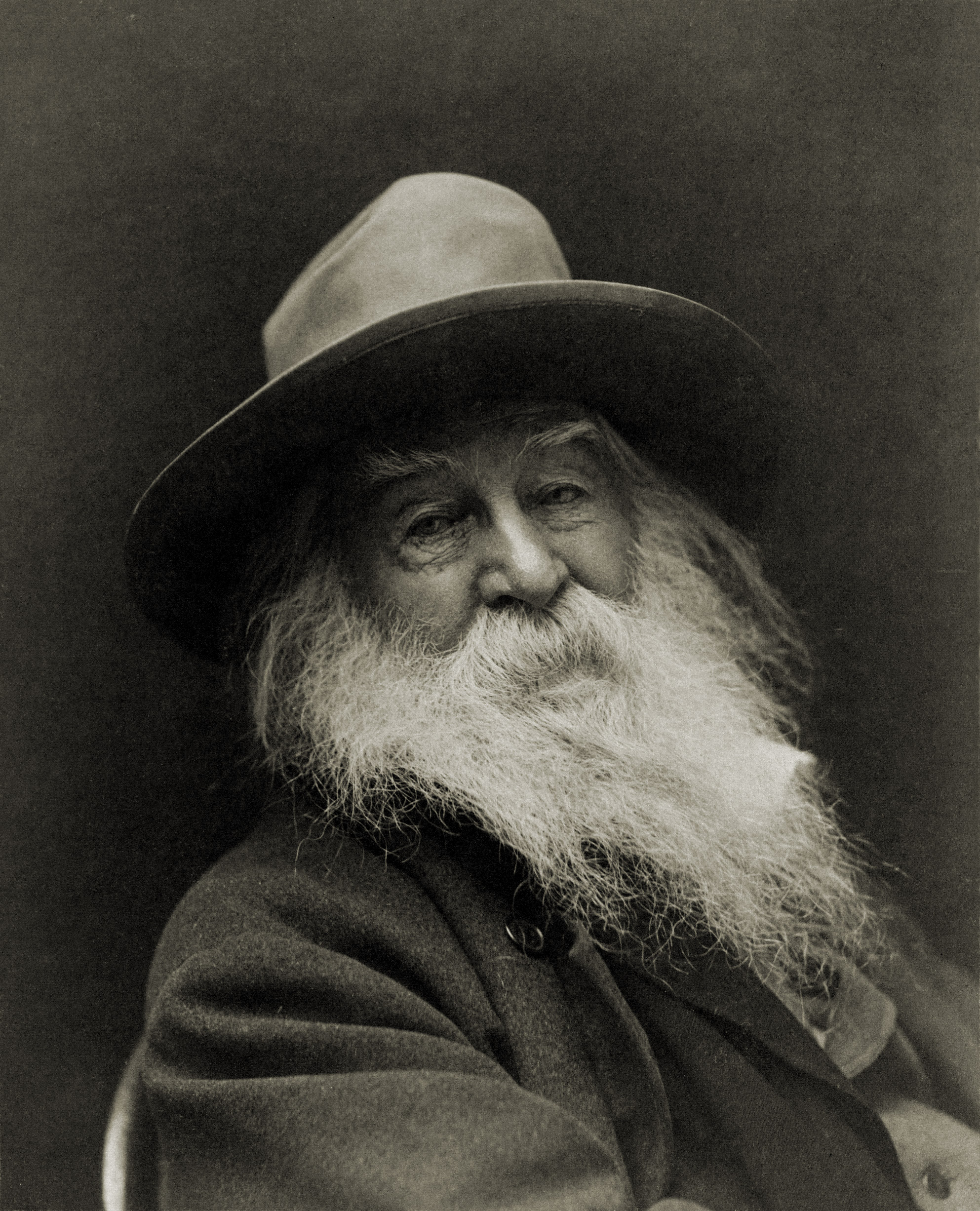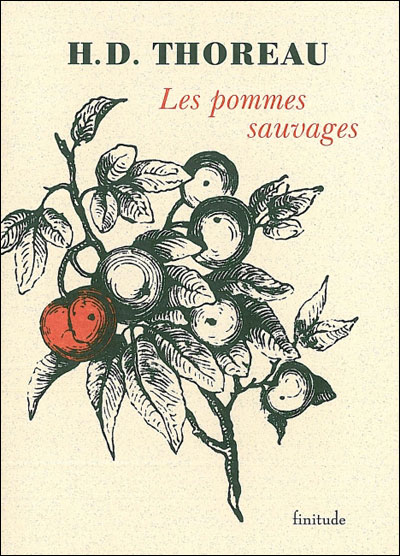Arrivés tard le samedi soir, nous avons pu assister à la “nuit indienne” intitulée Rising Stars, nuit consacrée à la découverte de jeunes artistes prometteurs de musique classique indienne.
La soirée commençait, à 23h00, par un spectacle de danse de Rama Vaidyanathan, accompagnée de son ensemble. Jeune artiste talentueuse, Rama Vaidyanathan s'est donnée corps et âme à une ancienne danse rituelle, la danse bharata natyam, qui consiste à danser les vieilles légendes mythologiques hindoues. Il s'ensuit une danse extrêmement évocatrice, à la limite du mime parfois, qui raconte de manière virtuose et évocatrice les aventures de Krishna , Shiva et des autres divinités du panthéon indien. Il faut souligner que Rama Vaidyanathan a eu le souci de faire partager le maximum de son art avec le public, dans la mesure où elle racontait les mythes en les mimant avant d'entamer chacune de ses danses, accompagnées par un flûtiste, un joueur de tabla et une chanteuse. Le spectacle était splendide, et c'était probablement la partie de la nuit indienne que j'ai préféré, très probablement en partie du fait que mon attention fatiguée a baissé pendant les deux autres spectacles.
La seconde partie de la nuit était consacrée à un concert de trois musiciens virtuoses d'Inde du nord, Debapriya Adhykary (chant khyal), Samanwaya Sarkar (sitar) et Madhurjya Barthakur (tabla, jugalbandi), qui dans la plus pure tradition hindustani ont improvisé sur un raga. Néanmoins, contrairement à l'habitude qui consiste à mettre en valeur un seul musicien en l'accompagnant de manière relativement discrète, le chanteur et le cithariste se sont ici partagé la vedette en dialoguant mélodiquement tout au long du concert, accompagnés par le joueur de tabla qui a également montré de quel bois il était fait vers la fin de la représentation. Trois musiciens virtuoses, pour un concert nettement plus contemplatif, mais tout aussi fascinant que le premier.
Le troisième concert, qui a commencé vers 1h30 du matin environ, s'est déroulé devant une assemblée plus éparse. Pourtant, il est très rare d'avoir l'occasion d'entendre un concert de shehnaï, le hautbois indien. Les frères Sanjeev & Ashwani Shankar, accompagnés d'un musicien occidental étudiant l'art du shehnaï en Inde ont pu nous faire découvrir cet instrument avec l'accompagnement traditionnel des tablas et de la tampura. Vous pouvez voir et entendre un extrait ici. Que dire sinon que, à 2h00 du matin, sous le chapiteau du festival, on se serait cru dans un temple lointain? En entendant cet instrument, j'ai compris pourquoi il avait tant servi à orner les rituels religieux: le son est empreint d'une telle emphase, d'une telle profondeur qu'il est particulièrement apte à donner une image, mobile et éternelle, du sacré.
Le lendemain matin, nouveau spectacle de Rama Vaidyanathan. Le spectacle avait lieu cette fois-ci au palais Briau, un improbable ensemble d'édifices, pour moitié en ruines, donnant sur la Loire au milieu d'un immense parc. L'ensemble, tout de brique mais imitant l'architecture des villas italiennes, avait autrefois été construit pour un grand industriel du chemin de fer du Second Empire. Dans l'entrée du palais transformée pour l'occasion en salon de danse oriental, on se serait cru dans le Salon de musique de Satyajit Ray. Les danses de Rama, ce matin, tournaient autour du dieu Krishna, grand flutiste s'il en est.
La danseuse nous a ainsi raconté une splendide lamentation aux oiseaux, où une femme amoureuse de Krishna, harangue les volatiles autour d'elle, la perruche, l'aigle, etc., en leur demandant de porter sa plainte au dieu pour qu'il vienne à lui. Jamais la mythologie de l'oiseau transport de l'âme vers les dieux ne m'a semblé aussi proche. Cela m'a rappelé une autre soirée, où d'autres histoires d'oiseaux nous avaient été contées. Décidément, je crois que j'aime les oiseaux autant que j'aime les arbres, surtout quand ils sont chantés, dansés, joués, racontés de cette merveilleuse manière.
La seconde partie de la nuit était consacrée à un concert de trois musiciens virtuoses d'Inde du nord, Debapriya Adhykary (chant khyal), Samanwaya Sarkar (sitar) et Madhurjya Barthakur (tabla, jugalbandi), qui dans la plus pure tradition hindustani ont improvisé sur un raga. Néanmoins, contrairement à l'habitude qui consiste à mettre en valeur un seul musicien en l'accompagnant de manière relativement discrète, le chanteur et le cithariste se sont ici partagé la vedette en dialoguant mélodiquement tout au long du concert, accompagnés par le joueur de tabla qui a également montré de quel bois il était fait vers la fin de la représentation. Trois musiciens virtuoses, pour un concert nettement plus contemplatif, mais tout aussi fascinant que le premier.
Le troisième concert, qui a commencé vers 1h30 du matin environ, s'est déroulé devant une assemblée plus éparse. Pourtant, il est très rare d'avoir l'occasion d'entendre un concert de shehnaï, le hautbois indien. Les frères Sanjeev & Ashwani Shankar, accompagnés d'un musicien occidental étudiant l'art du shehnaï en Inde ont pu nous faire découvrir cet instrument avec l'accompagnement traditionnel des tablas et de la tampura. Vous pouvez voir et entendre un extrait ici. Que dire sinon que, à 2h00 du matin, sous le chapiteau du festival, on se serait cru dans un temple lointain? En entendant cet instrument, j'ai compris pourquoi il avait tant servi à orner les rituels religieux: le son est empreint d'une telle emphase, d'une telle profondeur qu'il est particulièrement apte à donner une image, mobile et éternelle, du sacré.
Le lendemain matin, nouveau spectacle de Rama Vaidyanathan. Le spectacle avait lieu cette fois-ci au palais Briau, un improbable ensemble d'édifices, pour moitié en ruines, donnant sur la Loire au milieu d'un immense parc. L'ensemble, tout de brique mais imitant l'architecture des villas italiennes, avait autrefois été construit pour un grand industriel du chemin de fer du Second Empire. Dans l'entrée du palais transformée pour l'occasion en salon de danse oriental, on se serait cru dans le Salon de musique de Satyajit Ray. Les danses de Rama, ce matin, tournaient autour du dieu Krishna, grand flutiste s'il en est.
La danseuse nous a ainsi raconté une splendide lamentation aux oiseaux, où une femme amoureuse de Krishna, harangue les volatiles autour d'elle, la perruche, l'aigle, etc., en leur demandant de porter sa plainte au dieu pour qu'il vienne à lui. Jamais la mythologie de l'oiseau transport de l'âme vers les dieux ne m'a semblé aussi proche. Cela m'a rappelé une autre soirée, où d'autres histoires d'oiseaux nous avaient été contées. Décidément, je crois que j'aime les oiseaux autant que j'aime les arbres, surtout quand ils sont chantés, dansés, joués, racontés de cette merveilleuse manière.